
Je suis « tombée » sur Jean-Baptiste Jeangène Vilmer* par hasard, en mai dernier, alors qu’il était l’invité de Christiane Charrette, animatrice vedette sur Radio Canada. Dans son dernier ouvrage, « Ethique animale », Jean-Baptiste Jeangène Vilmer pose une question à mon sens fondamentale : quelle est la responsabilité des humains vis-à-vis des animaux (sauvages ou domestiques, d’élevage ou de laboratoire, de travail, de cirque ou de zoo, destinés aux divertissements, la corrida, les combats ou autres) ? Pourquoi le fait que l’animal soit moins intelligent que l’humain rendrait acceptable de l’asservir et de le faire souffrir ?
A pas de loup…
Faites l’essai de parler de défense des animaux ou expliquez simplement que vous êtes végétarien (même si vous ne l’êtes pas ; ceci est un exercice, pas le jeu de la vérité…) par empathie envers les bêtes (plutôt que pour lutter contre la malbouffe, petite excentricité désormais admise par la plupart des gens) et observez les réactions. A moins qu’ils ne partagent votre point de vue, vos interlocuteurs ne pourront s’empêcher de tourner immédiatement vos convictions en ridicule en citant presque à coup sûr les activistes les plus médiatisés (Brigitte Bardot et son discours simpliste quand il ne frise pas l’hystérie; les propos provocateurs du canadien Paul Watson, le fondateur de Sea Shepherd Conservation Society, dénonçant le massacre de centaines de milliers de phoques au Canada ,…) ou encore ils s’insurgeront contre les militants anti vivisection, ces « illuminés » prêts à recourir au terrorisme pour se faire entendre. Ces profils existent bien sûr, mais ils représentent un infime pourcentage des sympathisants de la cause animale. Pourtant, c’est ce portrait trompeur, infantile, voire violent, qui impose l’image réductrice d’un humain préférant les bêtes à ses congénères qui colle à la peau du défenseur du bien-être animal. Voilà une bonne raison d’avancer à pas de loup sur ce terrain glissant…
Débat sur l’éthique animale contre anti-animalisme primaire
Jean-Baptiste Jeangène Vilmer n’est encore qu’un jeune homme (il n’a que 28 ans…) mais il est déjà très sage, et brillant. Bardé de diplômes, obtenus dans des institutions plus prestigieuses les unes que les autres (doctorat en études politiques à l’EHESS ; Ph.D. en philosophie à l’Université de Montréal ; diplôme de droit à McGill ; Post Graduate Fellow à Yale University,…) il s’intéresse depuis plusieurs années à l’éthique. Dans son dernier ouvrage, « Ethique animale », il pose une question à mon sens fondamentale : quelle est la responsabilité des humains vis-à-vis des animaux (sauvages ou domestiques, d’élevage ou de laboratoire, de cirque ou de zoo, utilisés dans les divertissements comme la corrida, les combats ou autres) ? Pourquoi le fait que l’animal soit moins intelligent que l’humain rendrait acceptable de l’exploiter et de le faire souffrir ? Question fondamentale, mais non essentielle aux yeux de la grande majorité des individus qui ont évidemment d’autres priorités (protéger leur famille, gagner leur vie, rembourser l’hypothèque de leur maison, payer leurs impôts, éradiquer la pauvreté ou la faim dans le monde,…). La plupart d’entre nous considère que les problèmes des humains sont nécessairement plus importants que les questions liées aux animaux. « La position de principe du « soucions-nous d’abord de l’homme » n’est souvent qu’un alibi pour les gens qui ne se soucient de rien du tout. » écrit d’ailleurs l’auteur tout en ajoutant que lutter pour la cause de l’un n’empêche pas de se battre pour celle de l’autre.
Cette réflexion est nécessaire si l’on considère le fait que plus de 100 milliards de bêtes (sans compter les poissons) sont abattues chaque année dans le monde pour nourrir la planète (pour être exact, disons plutôt « une partie des humains de la planète »…). Pour reprendre les chiffres indiqués par l’auteur, « l’homme consomme annuellement plus de 53 milliards d’animaux par an (dans l’ordre : poulets, canards, porcs, lapins, dindes, moutons, chèvres, bovins, et chevaux. ». Ce qui, en Occident représente « 98% de la totalité des animaux avec lesquels les humains sont en interaction. (…) Les abattoirs américains tuent plus de 23 millions d’animaux par jour. (…) Selon les estimations de l’ONU (FAO) la production mondiale de viande et de lait doublera d’ici à 2050. ».
La FAO met d’ailleurs en garde contre les dégâts causés par l’élevage sur l’environnement et rappelle que produire de la viande et du lait pollue les sols, l’air et l’eau. L’auteur cite son rapport : « 70% des forêts amazoniennes ont déjà été converties en pâturages.(…) L’élevage émet davantage de gaz à effet de serre (18%) que les transports (12%).(…) Le bovin réchauffe davantage (le climat) que la voiture… (…) Le fumier lorsqu’il atteint des concentrations excessives et qu’il s’entasse à un même endroit, pénètre profondément dans les sols et contamine des nappes phréatiques, des lacs et des rivières, tue la faune aquatique et menace même l’eau potable. (…) Le coût environnemental d’un élevage en pleine expansion restera l’un des défis majeurs des prochaines générations. ».
Il est à noter également que l’expérimentation animale (recherches en laboratoires, universités, armée, fabricants de cosmétiques ou de produits ménagers,…) est une grosse consommatrice de cobayes. Plus de 100 millions de souris, rats, hamsters, lapins, mais aussi cochons, singes et chiens, dont 2 millions en France, sont concernés. De son côté, l’industrie de la fourrure est la cause de la mort (souvent dans des conditions atroces) de plus de 50 millions d’animaux (visons, renards, lapins, loups, ratons laveurs, chinchillas, zibelines, lynx, putois, gloutons, ragondins,…) par an, dont le quart aux USA précise l’auteur, qui ajoute quelques pages plus loin : « les marchés de chiens et chats en Asie sont bien connus et représentent un marché de plusieurs millions de peaux par an » ! Voilà, à mon sens, autant de raisons valables pour lancer le débat sur une éthique animale digne de ce nom.
Du sexisme au spécisme
Dans cet ouvrage, le lecteur « non initié » à la cause animale découvrira plusieurs notions intéressantes, à commencer par « l’éthique animale » elle-même, c’est-à-dire « l’étude de la responsabilité morale des hommes à l’égard des animaux pris individuellement » pour reprendre la définition recommandée par l’auteur. Mais aussi le « spécisme », un terme désignant la discrimination selon l’espèce inventé en écho aux mots « racisme » et « sexisme », et qui dévoile à quel point notre compassion pour les bêtes dépend de leur proximité avec nous, voire de leurs points communs et de leurs ressemblances avec l’humain. Un exemple simple : refuser de manger du chien, du dauphin ou du cheval tout en acceptant de se nourrir de veaux, vaches, cochons,… relève du spécisme. On donne la préférence aux animaux « domestiques » ou bénéficiant d’un capital sympathie sur les animaux de ferme parce qu’ils font partie de la famille en quelque sorte. Ils ne sont pas de la même espèce que l’animal humain, mais leur espèce est plus digne d’être protégée que certaines autres espèces animales dont il est pourtant démontré scientifiquement qu’elles peuvent également souffrir. D’après les psychanalystes, cette réaction est « humaine » et naturelle. Cela dit, pas besoin d’être psy pour constater quotidiennement que chacun d’entre nous préfère généralement les membres de sa propre espèce aux animaux, sa progéniture à celle de son voisin, son cercle familial à des inconnus, le groupe social, intellectuel, politique,… auquel il s’identifie plutôt que les autres groupes, son chien ou son chat à ceux de ses voisins, voire son chien à son voisin… Bref, puisque c’est dans la nature des choses, soyons honnêtes : chacun de nous est plus ou moins spéciste. Pour l’auteur, « la première cause du spécisme est l’ignorance, celle du monde animal et surtout de la manière dont l’homme traite les animaux. ». Une ignorance plus ou moins volontaire, précise-t-il car « Le citoyen est responsable de ne pas trop chercher à en savoir plus. ». Selon lui, « il sait, ou du moins le devine, que la condition animale n’est guère reluisante dans les fermes d’élevage. (…) mais il préfère ne pas trop creuser le problème, de peur sans doute d’avoir à remettre en cause certaines de ses chères habitudes. ».
Et de rappeler que l’image idyllique des animaux de basse-cour libres d’aller et venir en picorant a fait long feu. Il n’existe quasiment plus de fermes « à l’ancienne » et pour cause ! L’optimisation des coûts et la recherche du profit à outrance a fait disparaître les fermiers traditionnels, explique encore l’auteur. En effet, l’élevage intensif est une réalité et va continuer à se développer de manière exponentielle au cours des prochaines décennies au motif qu’il faut nourrir de plus en plus de gens sur la planète.
Délit d’ignorance
Voilà un jugement sur le délit d’ignorance du citoyen bien sévère car celui-ci ignore souvent les conditions dans lesquelles sont parquées, nourries, manipulées et abattues les bêtes d’élevage. Je me ferai l’avocat du diable en plaidant que, s’il est vrai que beaucoup ne se posent même pas la question, une majorité de consommateurs pense que les animaux élevés pour leur fourrure sont bien traitées parce que, s’il on en croit le discours des éleveurs : « Si l’on veut une belle fourrure, brillante et soyeuse, il faut éviter le stress des animaux. Donc, on les traite bien et on les nourrit bien. ». De même, la plupart des mangeurs de viande pense que, sauf exception, les bêtes disposent d’un espace satisfaisant, sont nourries correctement, manipulées avec humanité, transportées dans des conditions sanitaires acceptables, anesthésiées avant la castration et l’abattage, etc et cela, même dans les élevages industriels, voire surtout dans ces élevages « extrêmement réglementés »... La loi française et au-delà européenne ne prévoient-elles pas d’obliger ceux qui travaillent avec des animaux destinés à l’abattoir de les traiter avec un minimum de considération ? La plupart d’entre nous pense aussi que les essais sur les animaux de laboratoires, en particulier concernant la toxicité des cosmétiques ou des produits ménagers, sont interdits depuis belle lurette. Il n’en est rien, bien qu’une grande partie de ces expériences pourrait être éliminée car des méthodes alternatives sont possibles.
Les lois existent et sont, paraît-il, bien appliquées nous serine-t-on régulièrement par le biais des médias. Tout au moins dans les pays occidentaux. Les mauvais traitements seraient l’exception. Voilà qui a effectivement de quoi rassurer le carnivore humain ignorant donc innocent… jusqu’à ce qu’il ouvre le livre de Jeangène Vilmer !
Si l’on se réfère à la liste des abus figurant dans la partie II du livre, il y a effectivement matière à s’inquiéter et à convertir au végétarisme le moins docile des amateurs de chair fraîche... L’auteur évoque certains traitements barbares courants (confinement, entassement, mutilation des ailes, « débecquage » et castrations à vif, isolement, stress permanent, manipulations génétiques…) et fait heureusement grâce au lecteur des détails les plus sordides (c’est dire…). La lecture deviendrait vite insoutenable et le but n’est pas de déprimer le lecteur, mais de lui faire prendre conscience de la réalité des faits, et peut-être un peu aussi de son ignorance coupable…
L’élevage intensif, mais aussi l’exploitation des animaux sauvages dans les cirques ou les zoos (sous couvert de préservation des espèces protégées), des cobayes de laboratoires, l’élevage pour la fourrure et j’en passe, engendrent des souffrances physiques pour l’animal. Sans parler de la souffrance psychologique, mais les « anti-animalisme » primaires pourraient voir dans cette remarque un zeste de sensiblerie, voire de l’anthropomorphisme. Un alibi souvent utilisé pour étouffer toute compassion des humains envers les bêtes et discréditer ainsi intellectuellement ceux qui en font preuve.
Les puissants lobbies alimentaires (au passage, la France est le premier producteur mondial de foie gras et le troisième de volailles et se défend plutôt bien dans les autres domaines alimentaires) se font fort de présenter des animaux en bonne santé et heureux de leur sort dans leurs publicités. Pour chaque documentaire télé dénonçant les mauvais traitements aux animaux d’élevage (mais ça marche aussi pour la chasse ou les cirques et les zoos) un démenti catégorique est diffusé dès le lendemain sur toutes les chaînes et les grandes radios. Les professionnels visés s’insurgeant contre l’amalgame facile, la propension des médias à faire d’un cas exceptionnel de torture sur un animal une généralité, l’exagération d’« animalistes » toujours en quête de publicité (vous noterez comme « animalisme » sonne de manière péjorative à la façon de « droits-de-l’hommisme »). Pourtant, le « concept » même d’élevage intensif, devrait nous inciter à réfléchir sur « l’amour » que peuvent porter, dans le contexte d’un élevage industriel, les éleveurs à leurs bêtes…
Discours-alibi et autres tentatives de justification
Jean-Baptiste Jeangène Vilmer dénonce également les « discours-alibis » destinés à justifier l’élevage intensif, la chasse, l’expérimentation ou toute autre forme d’exploitation des animaux précédemment évoquée. Je ne citerais que les plus populaires : l’alibi de la tradition suggérant qu’une chose est bonne parce qu’on la pratique depuis toujours. Comme le fait remarquer avec pertinence l’auteur, si l’on s’en tenait à ce type de raisonnement, le cannibalisme, la peine de mort ou l’excision,… seraient autant de traditions à conserver… L’alibi économique est un autre grand classique. Si la chasse aux phoques rapporte 20 millions de dollars et est créatrice d’emplois et que la filière française du foie gras représente 30.000 emplois, doit-on pour autant en déduire que la légitimité d’une action se juge à l’aulne des profits qu’elle peut rapporter ? comme le souligne à nouveau l’auteur, tout en ajoutant non sans une pointe d’humour noir : « …sans quoi le trafic d’armes et de drogue seraient fort respectables ».
Le juriste-philosophe explique également la différence entre « abolitionnistes » et « réformistes ». Les abolitionnistes réclament la fin de l’exploitation des animaux sous toutes ses formes (alimentation, laboratoires, cirques, zoos, fourrure, domestiques, travail, etc). Certains d’entre eux, plus modérés –ou plus réalistes- considèrent qu’il faudra accepter de « réformer » les conditions dans lesquelles sont maintenus les animaux (pour améliorer leur bien-être) avant de parvenir à abolir totalement l’exploitation animale. Il s’agirait donc d’un moindre mal dans le cas présent.
Dès le début du livre, l’auteur opère une distinction entre les « animaux non humains » et les « animaux humains » pour désigner l’homme qui d’un point de vue biologique est aussi un animal et, dans cette perspective, il défend la thèse de la différence de « degré » et non de « nature » (fondée sur le langage, la raison, la conscience de soi, la spiritualité, etc ) et soutient l’idée d’une continuité entre vivants et animaux. Il se présente comme un « welfariste » (anglicisme désignant un défenseur du « bien-être » animal plutôt qu’un défenseur des « droits » des animaux) et propose de « remettre l’homme à sa place ». L’auteur déplore l’influence du christianisme (qui place l’homme au centre de la création) sur la société française et souligne, par ailleurs, que la tradition « humaniste » est trop souvent synonyme d’anthropocentrisme. Le philosophe Jeangène Vilmer reproche en effet à Descartes d’avoir introduit une hiérarchie stricte entre l’homme (qui se place au centre de l’univers donc), les animaux et la nature qui lui seraient par conséquent subordonnés. « L’on se persuade qu’augmenter la considération pour l’un ferait immanquablement chuter l’autre(…). Comme si les droits de l’homme étaient en fait des droits contre les animaux et vice versa. » écrit-il. Il établit une distinction entre « l’éthique animale (qui) ne s’intéresse qu’aux êtres vivants sensibles, car elle fait de la souffrance son point de départ. » excluant par conséquent « les plantes, les entités supra-individuelles (forêts, espèces, écosystème) et le monde abiotique » relevant de l’éthique environnementale.
Ni des machines, ni des humains, ni des idoles…
Jean-Baptiste Jeangène Vilmer adhère à l’idée selon laquelle « la protection du faible exige de condamner toute cruauté envers les animaux. (…) Autrement dit, l’homme peut chasser pour se nourrir (chasse de subsistance) mais pas pour se divertir (chasse sportive). ». Il suit un raisonnement logique : « Si je m’interdis de blesser ou de tuer un homme, ce n’est pas par considération pour ses facultés intellectuelles –il pourrait s’agit d’un nourrisson ou d’un handicapé mental-(ce qu’on appelle les « cas marginaux ») (…)C’est tout simplement parce qu’il est un être sensible, capable de souffrir. ». Dans ces conditions, pourquoi l’homme s’arrogerait-il le droit de faire subir aux autres espèces ce qu’il proscrit pour ses congénères ? Faisant sienne la remarque de Salt, célèbre militant au XIXème siècle, prédisant la libération des animaux dans la lignée de celles des esclaves et des femmes, il écrit, à propos du droit des animaux, que « La risée d’une génération peut devenir la préoccupation de celle qui suit. ».
Comme le précise l’auteur à la fin de son livre, tout n’est pas noir heureusement et l’espoir d’améliorer, le bien-être animal, est permis. Par exemple, une directive de l’Union européenne interdit l’expérimentation animale pour les produits cosmétiques à partir de mars 2009. Une proposition de règlement visant à interdire le commerce de fourrure de chats et de chiens sur tout le territoire de l’Union européenne devrait également entrer en vigueur le 31 décembre prochain. Autre décision importante, la Commission européenne à décidé d’abolir l’élevage de veaux en batterie en 2007. Ce n’est qu’un début et l’évolution des mentalités reste pour l’instant limitée à l’Europe. Comme le souligne l’auteur, « l’Amérique reste à la traîne, sans parler du reste du monde. Le cas de la Chine est particulièrement préoccupant.(…) La plupart des abus qui sont la norme sont à peine questionnés aux Etats-Unis(…). Les cours d’éthique animale à l’université se multiplient, que ce soit en philosophie, en médecine vétérinaire ou en droit, mais cette fois, l’exemple à suivre est américain. ».
Comme le dit le psychanalyste et neuropsychiatre Boris Cyrulnik dans « La plus belle histoire des animaux » : « Les animaux ne sont ni des machines, ni des humains, ni des idoles(…). J’insiste là-dessus : le jour où l’on acceptera enfin qu’il existe une pensée sans parole chez les animaux, nous éprouverons un grand malaise à les avoir humiliés et considérés aussi longtemps comme des outils. ».
Quelques critiques…
Cet ouvrage se veut un livre de vulgarisation, mais il me semble qu’il s’adresse plutôt à un lectorat « averti ». La partie I, qui relève de l’épistémologie et présente les grandes avancées dans le domaine de l’éthique animale depuis sa création dans les années 1970 et fait référence aux grands courants et aux pères fondateurs qui ont fait avancer cette discipline, aurait été mieux à sa place en second. Evidemment, comme le suggère d’ailleurs l’auteur, rien n’empêche le lecteur de commencer par la partie II…
Une seconde partie qui pose le problème du traitement des animaux et de notre responsabilité à leur égard de façon plus pragmatique. La seconde moitié du livre relève davantage du concret, donc elle est plus accessible et plus proche des préoccupations du lecteur lambda. On peut regretter que l’auteur ait pris le risque de se couper d’un public moins intellectuel mais tout aussi curieux de découvrir cette notion d’éthique animale.
Il est à noter que Jean-Baptiste Jeangène Vilmer est un universitaire et peut-être souhaite-t-il s’adresser en priorité à ses pairs et aux étudiants. Si tel est le cas, je formule le vœu que certaines de ses conférences seront écrites pour un public moins érudit, mais tout aussi sensible à la question du traitement des animaux. En revanche, il est certain que ce livre répond à un manque. Il existe trop peu de publications sur le sujet et je suis heureuse que l’on doive cette intelligente démonstration à un penseur appartenant à la jeune génération. Une jeune génération d’intellectuels hélas sous-représentée dans les médias qui, bien souvent par paresse, préfèrent relayer le discours de « valeurs sûres » qui, à de rares exceptions près, monopolisent la parole depuis plusieurs décennies quant elles devraient s’efforcer de passer le relais à une relève pleine d’avenir et souvent talentueuse.
*Jean-Baptiste Jeangène Vilmer, diplômé en philosophie et en droit, est chercheur à l’Université Yale (Etats-Unis) après avoir été chargé de cours à l’Université de Montréal et attaché à l’Ambassade de France au Turkménistan. Il travaille actuellement en éthique des relations internationales sur l’intervention humanitaire armée. Il a publié une vingtaine d’articles en histoire de la philosophie, éthique appliquée, histoire diplomatique et droit international et plusieurs ouvrages dont « Sade moraliste » (Droz. 2005) et « La religion de Sade » (L’Atelier. 2008). Son prochain livre « Réparer l’irréparable. Les réparations aux victimes devant la Cour pénale internationale » paraîtra aux PUF en 2009.



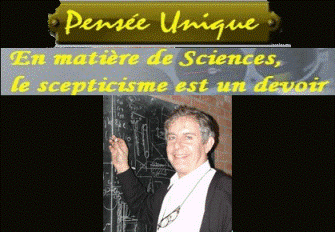





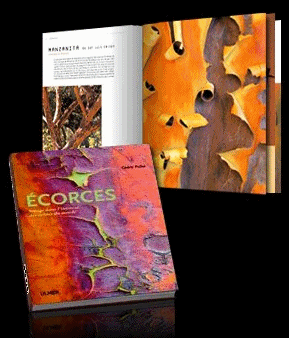
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire